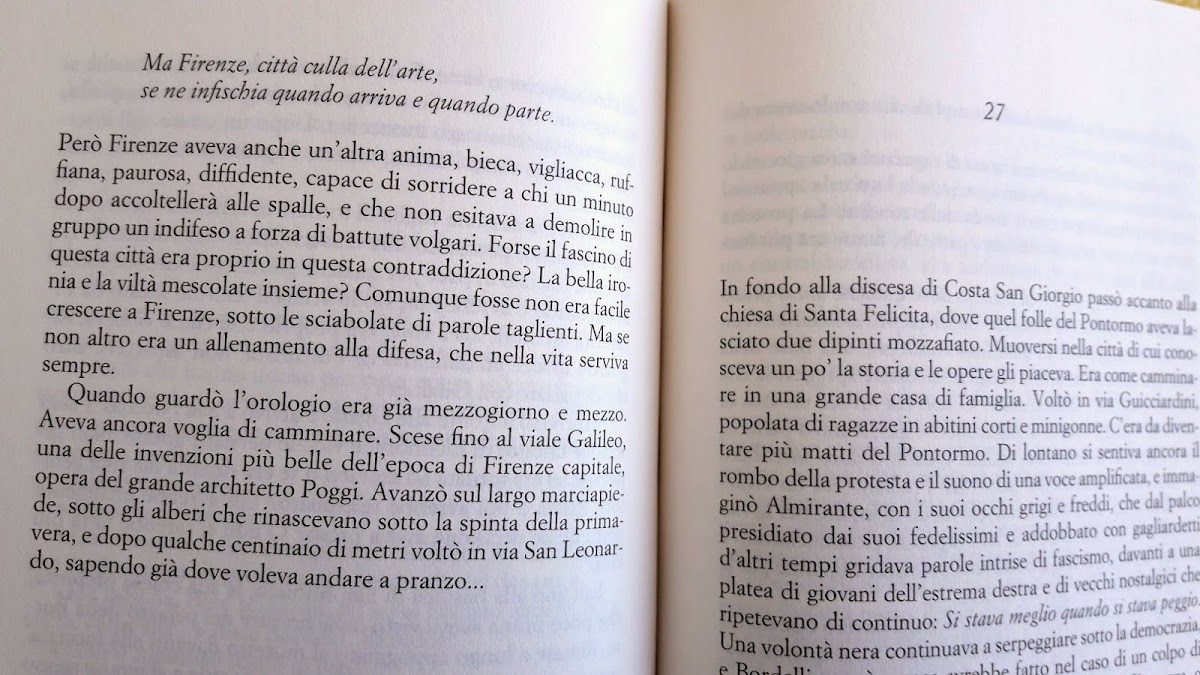Un deuxième (et dernier) extrait de Nel più bel sogno, le roman de Marco Vichi. Ici, le commissaire Bordelli assiste en 1968 au Moulin Rouge, un local situé au fond du célèbre parc des Cascine de Florence, à un concert de Don Backy, un chanteur très en vogue dans les années soixante et même un peu au-delà. Il est accompagné par sa vieille amie Rose, ex-prostituée et l'un des personnages "récurrents" les plus sympathiques de la série des aventures de Bordelli. Il est question dans ce passage de Canzone, le grand tube de Don Backy dont les premières paroles sont reprises dans le titre de l'ouvrage : Nel più bel sogno [Dans le plus beau des rêves]. L'avantage d'Internet est que l'on peut faire également entendre la chanson au milieu du texte, ce qui ajoute certainement à l'émotion et à la nostalgie que suscitent ce passage chez le lecteur :
Après une heure de musique Don Backy annonça le dernier morceau, What'd I Say, un rythm and blues de Ray Charles, et le groupe se déchaîna comme il faut. Le final se déroulait dans une sorte de dialogue complice entre Don Backy et le public :
Eeee... Eeee...
Oooo... Oooo...
Eeee... Eeee...
Ooo...
Ooo...
Tell me what'd I say...
Tell me what'd I say...
Bordelli aurait voulu se lancer dans la mêlée sur la piste de danse, mais le démon de la vieillesse le retenait par les oreilles. A l'inverse, Rose ne laissa pas passer l'occasion, elle alla sous la scène et se mit à bouger ses très expertes hanches devant Don Backy qui lui souriait, ce qui la mettait dans un état second. La chanson semblait ne vouloir jamais finir, pour le plaisir de tout le public, et après un long roulement de batterie arriva l'explosion finale. Don Backy et les membres de son groupe répondirent au délire d'applaudissements avec des saluts, et ils disparurent derrière une porte. Mais le public n'était pas d'accord, et une forêt de sifflets se leva pour exiger un bis.
« Il n'a pas chanté ma préférée » protesta Rose, comme une enfant qui n'a pas reçu pour Noël le jouet qu'elle avait demandé à l'Enfant Jésus.
« Alors je dois l'arrêter » dit Bordelli, en croisant ses poignets.
« Oh oui ! Comme ça, je le ramène à la maison ! »
« Et qu'est-ce que tu en ferais ? »
« Ne me le fais pas dire... »
« Il n'est pas trop jeune pour toi ? »
« Et c'est toi qui dis ça ? » dit Rose, en levant sa coupe pour se faire resservir du champagne. Bordelli ne pouvait pas répliquer, et il fit semblant de ne pas avoir entendu. Mais qu'y pouvait-il si la femme qu'il désirait le plus au monde avait trente ans de moins que lui ?
Les applaudissements ne furent pas vains. Dans la fumée des cigarettes apparut de nouveau Don Backy, tout seul, déchaînant de nouveaux applaudissements nourris. On entendit une base enregistrée de violons mélancoliques, et Rose posa sa main sur son cœur... Les violons se turent en laissant place à un piano...
Nel più bel sogno ci sei solamente tuuu... [Dans le plus beau des rêves, il n'y a que toi...]
Le silence se fit dans toute la salle.
Sei come un'ombra che non tornerà mai piùùù... [Tu es comme une ombre qui ne reviendra jamais plus...]
Sei come un'ombra che non tornerà mai piùùù... [Tu es comme une ombre qui ne reviendra jamais plus...]
Dans l'obscurité on voyait briller des dizaines d'yeux, et les jeunes filles les plus effrontées étaient les plus émues de toutes. Rose la connaissait par cœur, et elle la murmurait du bout des lèvres en essuyant de temps en temps une larme avec ses doigts.
Bordelli suivait la mélodie et les paroles comme s'il avait lui-même écrit cette chanson. Combien de temps lui faudrait-il pour se remettre de cette soirée ? Il ne s'aperçut qu'à cet instant qu'il n'avait pas encore fumé la première cigarette de la journée, et il en profita pour en allumer une... Encore qu'avec toute cette fumée, c'est comme s'il en avait déjà fumé plusieurs.
Cette chanson pénétrait dans son âme à force d'émotions, en l'obligeant à penser à Eléonore, à désirer la serrer dans ses bras. La foule dans la salle était immobile, tous les regards étaient braqués sur ce garçon maigre à la voix dramatique et au visage de voyou sympathique, capable de t'arracher les tripes avec ses chansonnettes. Il n'était pas facile de comprendre pourquoi ce morceau était si beau, c'était même impossible. C'était comme ça et voilà tout...
Quand la dernière note s'évanouit dans le néant, tout le public se mit debout en frappant des mains, même les plus jeunes, même les jeunes filles effrontées. Don Backy esquissa un salut, envoya des baisers aux femmes et disparut. Les projecteurs braqués sur la scène s'éteignirent et les lumières plus douces de la salle s'allumèrent. Il y eut une tentative de révolte, pour demander encore un bis, mais hélas le concert était terminé, et peu à peu les applaudissements se transformèrent en bavardages, en éclats de rire et en commentaires enthousiastes.
Marco Vichi Nel più bel sogno Guanda Editore, 2017 (Traduction personnelle)