J'ai déjà cité ici un extrait de l'ouvrage de souvenirs d'Andrea Camilleri Esercizi di memoria (Exercices de mémoire), publié en Italie en septembre de l'année dernière. Je propose ici ma traduction de quelques extraits du dernier chapitre du livre, intitulé La Beauté entrevue.
Entre le territoire de mon village de Porto Empedocle et celui du chef-lieu Agrigente, il y a une longue colline qui s’appelle Monserrato. Quand dans mon enfance j’allais à la campagne chez mes grands-parents, je m’étais aperçu en observant avec des jumelles que dans la portion qui s’enfonçait dans l’arrière-pays surgissait un groupe de maisons. Je demandai à mon oncle qui y habitait, il me répondit qu'il s'agissait de deux familles : les Musumarra et les Condino. Il ajouta qu’il s’agissait de personnes ombrageuses qui ne fréquentaient personne et vivaient en vendant les produits de leur terre au marché du village. Il me dit aussi que les étrangers n’étaient pas les bienvenus, au point que si quelqu’un d’eux tombait malade, ils n’appelaient pas le médecin mais transportaient le malade à dos de mulet jusqu’au village. Ces nouvelles éveillèrent en moi une forte curiosité.
[Une première fois, le jeune Andrea se dirige vers ces maisons lointaines, mais il est tout de suite arrêté par deux chiens menaçants qui l’empêchent d’aller plus loin. Il revient au même endroit en octobre 43, après le débarquement des Américains. Il est accompagné par un écrivain sicilo-américain, Jerre Mangione, et cette fois-ci, il parvient à entrer en contact avec deux des habitants]
Ils nous firent entrer chez eux et nous offrirent du vin bien frais, puis ils s’excusèrent parce qu’ils devaient emmener au village une de leurs sœurs qui était très malade. Jerre leur dit qu’il pouvait les accompagner à l’hôpital militaire et ils acceptèrent. Pendant que la malade se préparait, l’un des deux nous dit :
« Je veux vous montrer quelque chose que nous avons découvert l’autre jour. »
Il nous conduisit dans l’autre bâtiment, nous y trouvâmes une grande pièce d’environ dix mètres sur quatre, complètement vide, qui devait avoir servi d’écurie pour les chevaux et en effet, l’homme nous expliqua qu’une semaine auparavant, un cheval soudain devenu furieux s’était mis à ruer en heurtant violemment un mur qui s’était effondré, laissant apparaître une autre cloison ornée d’une fresque [...] Nous regardâmes cette fresque et en fûmes émerveillés : elle était grande, environ six mètres sur quatre, on apercevait sur la gauche une paroi rocheuse d’où surgissait un large éperon sur lequel se tenaient deux moines, l’un âgé et l’autre plus jeune, il y avait aussi un chien étrange ; le moine le plus âgé désignait avec son bras tendu le paysage, justement celui que l’on apercevait du haut de la colline de Monserrato. Le ciel était d’un azur intense, avec quelques petits nuages blancs sur la partie droite du mur ; on voyait ensuite des champs ensemencés et dans le lointain les silhouettes des quatre villages, parmi lesquels se trouvait Agrigente : exactement le même paysage que l’on apercevait dans la réalité. Cela donnait une impression d’ampleur, de grandeur et en même temps de sérénité. Les coups de pinceaux étaient tracés avec une main sûre, il était certain que l’auteur de la fresque n’était pas un dilettante ou un naïf, il s'agissait de toute évidence de quelqu’un qui connaissait son métier, un artiste authentique, un véritable peintre. Tout en bas à droite, il n’y avait pas de signature mais seulement une date en chiffres romains : MCDXX. Il était difficile de quitter des yeux cette fresque, elle avait le charme secret des vraies œuvres d’art et nous ne pûmes pas cacher notre enthousiasme. Alors, heureux de notre réaction, le paysan nous conduisit vers une autre merveille. Nous sortîmes de la zone des habitations, empruntâmes un chemin étroit en surplomb et pénétrâmes dans une grotte ; elle était remplie d’eau mais une étroite passerelle de pierre permettait de rejoindre une autre grotte où était allumée une lampe à pétrole qui nous permit de distinguer une sorte d’autel de pierre, sur lequel était posée une sculpture qui représentait la Madone avec l’Enfant Jésus dans ses bras. C’était une sculpture de bois peint, elle avait la même intensité et la même magie que la fresque. Nous sortîmes à contrecœur, la malade était prête et nous descendîmes vers le village. [...]
Bien des années après, je parlai de cette fresque à mon ami sculpteur et grand artiste Angelo Canevari :
« J’aimerais bien y jeter un coup d’œil. » fut son seul commentaire.
Nous partîmes aussitôt pour la Sicile accompagnés de nos épouses respectives. Angelo m’avait expliqué qu’il était possible de détacher la fresque et de la placer sur une toile pour la transporter, à l’aide de certains procédés techniques qu’il connaissait. Nous arrivâmes à Porto Empedocle et le lendemain, nous rejoignîmes la maison de campagne qui nous servirait de point de chute. Dès que cela fut possible, nous allâmes à Monserrato et y fûmes accueillis par l’un des deux frères que j’avais connus, il avait beaucoup vieilli et il me dit que son frère était mort. Je lui expliquai que j’étais venu pour montrer à mon ami la fresque ainsi que la statue de la Madone. Il m’adressa un regard désolé et se contenta de me dire :
« Suivez-moi ! »
Nous rejoignîmes l’autre bâtiment, la grande salle avait été complètement rénovée, la fresque avait disparu.
Je lui demandai avec consternation : « Et qu’est-elle devenue ? »
« Il y a deux ans, il y a eu un tremblement de terre et tout s’est effondré. »
Il ouvrit l’un des quatre gros sacs qui se trouvaient dans un angle de la pièce, il en sortit une petite pierre dont l’un des côtés était peint d’un bleu intense.
« Toute la fresque a fini comme ça ! » me dit-il en me tendant la petite pierre.
« Et la Madone ? » lui demandai-je.
« Les grottes ont été englouties, tout a disparu ! »
C’était l’heure du repas, il nous invita à manger, mais nous refusâmes car nous n’avions vraiment plus d’appétit. Nous sommes rentrés découragés à la maison de mes grands-parents, et de temps en temps, je mettais la main dans ma poche pour caresser la petite pierre colorée, qui était la preuve tangible qu’autrefois, il m’avait été accordé la grâce d’entrevoir la Beauté.
Andrea Camilleri Esercizi di memoria Rizzoli Editore, 2017 (Traduction personnelle)
A voir ici une très intéressante rencontre avec Camilleri (93 ans, un esprit toujours aussi vif et une mémoire d'une infaillible précision) à propos de la parution des Esercizi di memoria. C'est en italien, sans traduction française.
Je rappelle l'adresse du site le plus complet sur Andrea Camilleri : http://www.vigata.org/index.html
A voir ici une très intéressante rencontre avec Camilleri (93 ans, un esprit toujours aussi vif et une mémoire d'une infaillible précision) à propos de la parution des Esercizi di memoria. C'est en italien, sans traduction française.
Je rappelle l'adresse du site le plus complet sur Andrea Camilleri : http://www.vigata.org/index.html











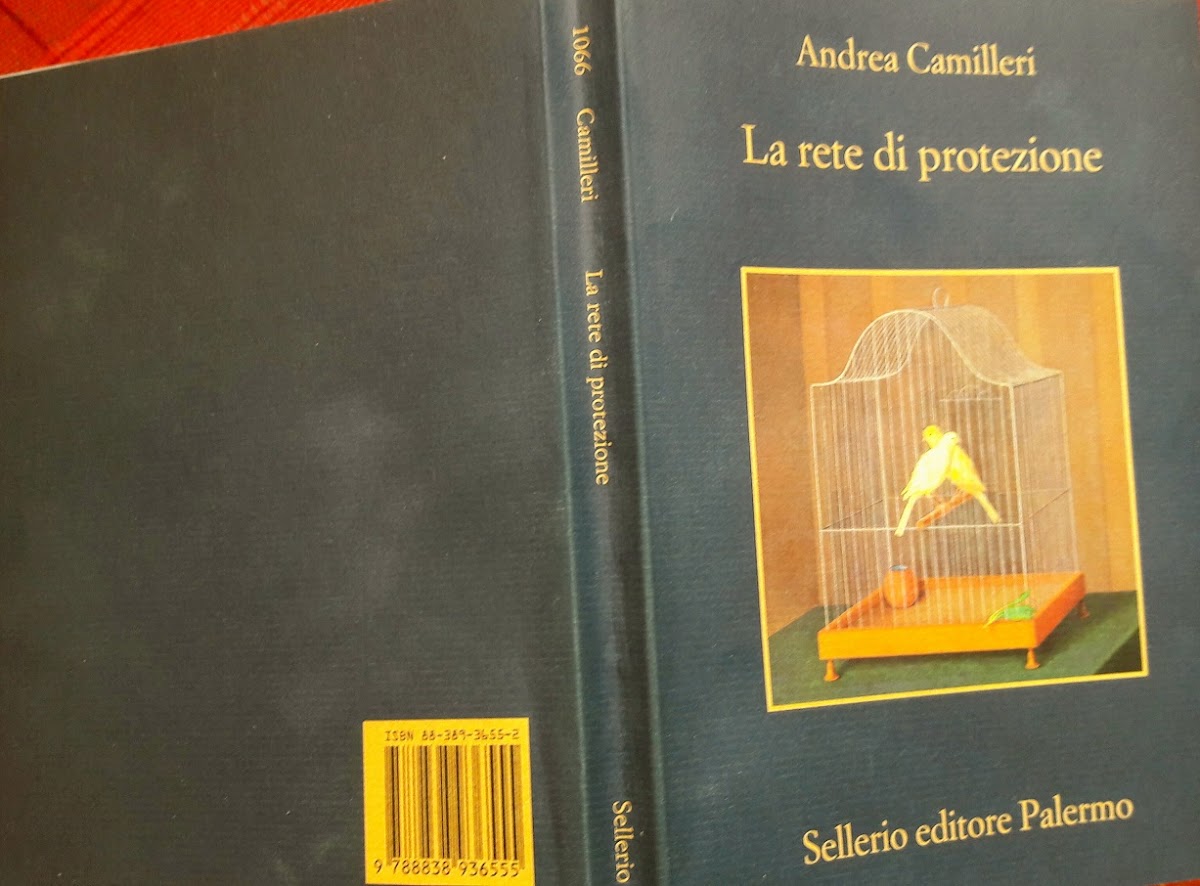






















.jpg)

