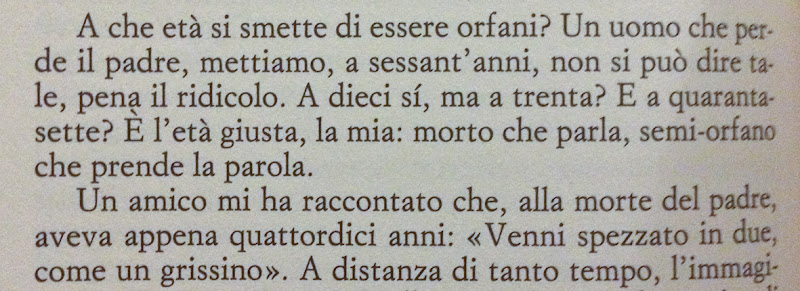Centomani
Un détour de la route et ce Basento funèbre,
Dans ce pays stérile, âpre, où, sur des collines,
Au loin, s’étendent de noires forêts pourrissantes.
Sur les interminables plateaux, pas un seul arbre.
Des cirques, des vallées vastes, sans verdure,
Où stagnent, avec des reflets de plomb, des eaux infernales
Issues des crevasses des lointaines montagnes de bitume
Dressées dans les régions désertes, sans routes et sans villages,
Près d’un Lago Nero, où semble demeurer éternellement
Un sombre et angoissant crépuscule d’hiver.
Te voici, rude Lucanie, sans un sourire !
Replis stygiens de ces ravins, ces roseaux noirs,
Ces chemins tortueux ouverts à tous les vents ;
J’ai donc vécu, jadis, en Basilicate,
Puisque ces souvenirs me restent bien vivants.
Un détour de la route, et ce Basento funèbre.
(C’est la route de Tito à Potenza ;
Ce talus de cailloux, c’est la ligne où ahanent
Les lents et lourds et noirs express Naples-Tarente.)
Il y a une maison de paysan, en ruines,
Inhabitée ; sur un des murs on a écrit
En français, ces mots peut-être ironiques : Grand Hôtel.
La prairie, à l’entour, est pâle et grise.
On m’a dit que l’endroit était nommé Centomani.
J’y suis venu souvent, pendant l’hiver 1903.
C’est une partie de ma vie que j’ai passée là,
Oubliée, perdue à jamais…
Arbres, ruines, talus, roseaux du Basento,
Ô paysage neutre et à peine mélancolique,
Que n’eûtes-vous cent mains pour barrer la route
À l’homme que j’étais et que je ne serai plus ?
Valery Larbaud Poésies d'A.O. Barnabooth

Centomani
La strada svolta, ed ecco questo Basento funebre,
Terra sterile, aspra, dove sulle colline
Lontano si distendono nere foreste putride.
Sugli altopiani immensi non c’è neppure un albero.
Circhi, vallate vaste, senza vegetazione,
Dove stagnano plumbee acque infernali uscite
Dai crepacci di monti lontani di bitume
Tra regioni deserte, senza strade o villaggi,
Vicino a un Lago Nero, dove sembra abitare
Un cupo ed angoscioso crepuscolo invernale.
Eccoti qui, Lucania, rude, senza un sorriso !
Stigi recessi delle forre, le canne nere,
E i tortuosi sentieri aperti a tutti i venti ;
Dunque, ho vissuto già in Basilicata,
Se i miei ricordi sono tanti vivi.
La strada svolta, ed ecco questo Basento funebre.
(E’ la strada di Tito per Potenza ;
La scarpata pietrosa è la linea in cui penano
Lenti, pesanti, neri treni Napoli-Taranto).
C’è una casa in rovina, casa di contadini
Disabitata; ma su di un muro, in francese,
Si legge, forse ironica, la scritta: Grand Hôtel.
I prati, tutt’intorno, sono pallidi e grigi.
Mi hanno detto che il posto si chiama Centomani.
Ci sono stato spesso, nell’inverno del 1903.
C’è un po’ della mia vita che ho trascorso laggiù,
Dimenticata, ormai, persa per sempre…
Piante, rovine, canne, scarpata del Basento,
Paesaggio neutro, appena malinconico,
Perché con cento mani non sbarraste la strada
All’uomo ch’ero e che non sarò più ?
Traduction : Valerio Magrelli
Un article de Valerio Magrelli sur le site du Giornale di filosofia : Dire e ridire. Larbaud vs Larbaud (cliquer au bas de la page pour accéder à l'article complet (en italien) au format PDF).
Images : en haut, Giuseppe Quattrone (Site Flickr)
en bas, Diego Buda (Site Flickr)
au centre, Viajero Italico (Site Flickr)
Images : en haut, Giuseppe Quattrone (Site Flickr)
en bas, Diego Buda (Site Flickr)
au centre, Viajero Italico (Site Flickr)