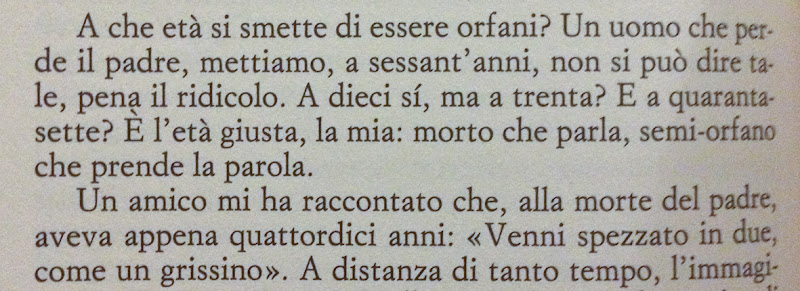When I heard at
the close of the day how my name had been receiv’d with plaudits in the
capitol, still it was not a happy night for me that follow’d,
And else when I
carous’d, or when my plans were accomplish’d, still I was not happy,
But the
day when I rose at dawn from the bed of perfect health, refresh’d, singing,
inhaling the ripe breath of autumn,
When I saw the full moon in the west grow
pale and disappear in the morning light,
When I wander’d alone over the beach,
and undressing bathed, laughing with the cool waters, and saw the sun rise,
And
when I thought how my dear friend my lover was on his way coming, O then I was
happy,
O then each breath tasted sweeter, and all that day my food nourish’d me
more, and the beautiful day pass’d well,
And the next came with equal joy, and
with the next at evening came my friend,
And that night while all was still I
heard the waters roll slowly continually up the shores,
I heard the hissing
rustle of the liquid and sands as directed to me whispering to congratulate me,
For the one I love most lay sleeping by me under the same cover in the cool
night,
In the stillness in the autumn moonbeams his face was inclined toward
me,
And his arm lay lightly around my breast – and that night I was happy.
Walt Whitman Leaves of grass, Calamus
Quand j’ai appris à la tombée du jour que mon nom avait été accueilli par des
applaudissements au Capitole, ce ne fut pas pour autant une nuit heureuse qui
suivit pour moi,
Et de même quand j’ai fait la fête, ou lorsque mes plans se
sont réalisés, je n’étais pas heureux pour autant,
Mais le jour où je me suis
levé à l’aube du lit de la santé parfaite, reposé, chantant, aspirant le
souffle mûr de l’automne,
Quand j’ai vu la pleine lune pâlir à l’ouest et
disparaître dans la lumière du matin,
Quand j’ai erré seul sur la plage et me
déshabillant me suis baigné, riant avec les eaux fraîches, et que j’ai vu le
soleil se lever,
Et quand j’ai pensé que mon cher ami mon amant était en chemin
vers moi, oh alors j’étais heureux,
Oh alors chaque bouffée d’air avait un goût
plus doux, et toute la journée les aliments m’ont mieux nourri, et la belle
journée s’est heureusement passée,
Et la suivante est arrivée avec une joie
égale, et avec le soir de la suivante est arrivé mon ami,
Et cette nuit-là
tandis que tout était calme j’ai entendu les eaux rouler lentement et sans
interruption le long du rivage,
J’ai entendu le bruissement sifflant de
l’élément liquide et du sable comme s’il s’adressait à moi en murmurant pour me
féliciter,
Car celui que j’aime plus que tout dormait étendu à mes côtés sous
la même couverture dans la nuit fraîche,
Dans le calme des rayons de lune
d’automne son visage était incliné vers moi,
Et son bras reposait légèrement
autour de ma poitrine – et cette nuit-là, j’étais heureux.
Traduction :
Renaud Camus (in
Chroniques achriennes, P.O.L, 1984)
Quando, sul finire
del giorno, udii che ero stato elogiato al Campidoglio, non fu felice per me la
notte che seguii ;
E così pure quando feci baldoria o quando i miei
progetti più importanti si attuarono, ancora non fui felice,
Ma il giorno in
cui all’alba mi alzai dal letto, in perfetta salute, elettrico, respirando una
dolce brezza,
Quando vidi la luna piena impallidire ad occidente e sparire
nella luce del mattino,
Quando solitario vagabondai sulla spiaggia e nudo mi
tuffai, ridendo con le onde, e vidi sorgere il sole,
E quando pensai che il mio
caro amico, il mio amante stava arrivando, oh, allora fui felice ;
Allora
ogni alito d’aria più dolce mi apparve, e tutto quel giorno il cibo meglio mi
nutrì, e lo splendido giorno trascorse felice,
E il giorno seguente arrivò con
uguale gioia, e il giorno dopo, di sera, arrivò il mio amico,
E quella notte,
mentre tutto taceva, udii le onde, lente, continue, frangersi contro la
spiaggia,
Udii il sibilante fruscio dell’acqua e della sabbia, come rivolto a
me, sussurrare per congratularsi,
Perché colui che amavo giaceva addormentato
accanto a me,
Nel silenzio, nella luce dei chiari raggi della luna, il suo viso
rivolto verso di me,
E il braccio leggero sul mio petto – e quella notte fui
felice.
Traduzione : Marina Tornaghi (in Calamus, Enola, 2000)
Images : de haut en bas, (1) Week-end (Andrew Haigh, 2011)