Qu'est-ce que la langue, et qu'est-ce que le dialecte ? Qu'exprime-t-on avec l'une et avec l'autre ? L'usage du dialecte nuit-il à la diffusion et à la pratique correcte de la langue ? Voici quelques unes des questions que se posent l'écrivain Andrea Camilleri et le linguiste Tullio De Mauro, à l'occasion d'un dialogue vivant et passionnant recueilli dans un ouvrage qui vient de paraître en Italie : La lingua batte dove il dente duole (La langue bute toujours sur la dent qui fait mal). Je traduis ici quelques extraits de ce livre, autour des liens qui unissent en Italie la langue et les dialectes ; on verra que les deux interlocuteurs n'ont pas tout à fait sur ce point les mêmes points de vue, le dialecte étant avant tout pour Camilleri "la langue des émotions, des sentiments", alors que De Mauro en propose une vision plus ample, plus complexe, à partir des observations qu'il a pu faire en Sicile.
On remarquera également la belle métaphore utilisée par Camilleri pour définir les rapports entre la langue et le dialecte, la première étant l'arbre et le second la sève qui le nourrit. L’œuvre de ce grand écrivain "italien d'origine sicilienne", comme il aime à se définir, est la réalisation concrète de cette union, de ce mélange d'italien et de sicilien qui caractérise le style inimitable de Camilleri (par exemple dans les histoires du commissaire Montalbano, mais aussi dans ses romans historiques, parmi lesquels je citerais ces chefs-d’œuvre que sont Il Birraio di Preston (édition française : L'Opéra de Vigata, Fayard), La Concessione del telefono (édition française : La Concession du téléphone, Fayard) et Il Re di Girgenti (édition française : Le Roi Zozimo, Fayard)).
ANDREA CAMILLERI : Le dialecte est
toujours la langue des sentiments, une chose confidentielle, intime, familiale.
Comme le disait Pirandello, la parole dialectale est la chose elle-même, parce
que le dialecte exprime le sentiment de cette chose, alors que la langue en exprime le concept.
Chez moi, on parlait un mélange de dialecte et d’italien. Un
jour, j’ai analysé une phrase que ma mère m’avait dite quand j’avais dix-sept
ans : il m’arrivait de plus en plus souvent de rentrer tard dans la nuit et
elle m’avait donné les clés de la maison. Elle me dit : « Figliu mè,
vidi ca si tu nun torni presto la sira e io nun sento la porta ca si chiui, nun
arrinescio a pigliari sonnu. Restu viglianti cu l’occhi aperti. E se questa
storia dura ancora io ti taglio i viveri e voglio vedere cosa fai fuori alle
due di notte ! ». [« Mon fils, si tu ne rentres pas plus tôt
dans la nuit et si je ne t’entends pas refermer la porte, je n’arrive pas à
dormir. Je ne ferme plus l’œil de toute la nuit. Et si cela continue ainsi, je
te coupe les vivres et il faudra bien que tu te débrouilles quand tu te
retrouveras dehors à deux heures du matin ! »]
Ça alors, me dis-je,
la première partie de ce discours [les deux premières phrases en sicilien] porte la marque des sentiments,
alors que dans la seconde [la dernière phrase en italien] entrent en jeu le notaire, la justice, le
commissaire, le respect des lois.
Ma relation avec le dialecte, avec la langue
du cœur, comme on pourrait le dire pour simplifier alors que les choses sont
beaucoup plus complexes, est vraiment passionnante. Et mon point de vue est
celui d’un écrivain. Il m’arrive d’utiliser des mots dialectaux qui expriment
exactement, avec la perfection lisse d’un galet, ce que je voulais dire, et je
ne trouve pas l’équivalent dans la langue italienne.
Ce n’est pas seulement une
question de cœur, mais aussi de tête. La tête et le cœur. C’est une relation
parfaitement articulée. Je ne vis plus en Sicile depuis soixante ans, il n’y a
pas de siciliens dans ma famille, mon épouse est romaine mais elle a fait ses
études à Milan, mes filles sont toutes nées à Rome, aucune d’entre elles ne
connaît le sicilien. Il peut se passer un an, et même plus, sans que je parle
sicilien. Alors, mon cerveau choisit les mots du dialecte à travers une formule
de gain et de perte, dans ma mémoire reviennent des mots qui — j’attire ton
attention sur ce point — sont les plus éloignés de l’italien, mais qui sont
restés gravés en moi depuis ma naissance, alors que j’ai oublié ceux que j’ai
pu apprendre par la suite.
Dans ma famille, en Sicile, on ne parlait pas un
dialecte très pur. Bien sûr, quand on parlait avec les métayers de mon
grand-père, on était bien obligés de le faire en sicilien. Toutefois dans notre
famille, une famille de la moyenne bourgeoisie, on utilisait en général, comme
je te le disais, un mélange d’italien et de sicilien, l’italien servant à
souligner, à mettre au clair, à prendre les distances, comme dans la
formule : « Tiens-le-toi pour dit ! ». Tout le reste était
en dialecte.
(...)

TULLIO DE MAURO : Le fait est que le dialecte n’est pas uniquement la langue
des émotions. C’est justement en Sicile que je l’ai compris, moi qui ne suis
pas sicilien, quand je suis arrivé à Palerme comme professeur d’université,
chaleureusement accueilli dans les familles de mes collègues siciliens, comme Franca, l'épouse milanaise de ton oncle, le fut dans la tienne. C’était en 1964. Quand nous étions à
table, pour le déjeuner ou le dîner (ils étaient tous très hospitaliers), on
commençait à parler en italien. Mais dès que la discussion devenait plus animée
— et quand
Sciascia était parmi nous, cela arrivait souvent — par exemple quand
il était question de politique, le registre de langue changeait aussitôt. Petit
à petit, ils glissaient vers le sicilien, et oubliaient complètement l’italien.
Les hommes utilisaient le dialecte pour aborder les sujets intellectuellement
plus importants (il n’en allait pas de même pour les femmes ; même en
1964, elles ne parlaient entre elles qu’en italien, quel que soit le sujet de la
discussion, même si elles connaissaient le dialecte). Le fait est qu’à Venise
comme à Palerme, quand la discussion devient sérieuse, on utilise le dialecte.
Aujourd’hui encore, le passage au dialecte de quelqu’un qui connait
parfaitement l’italien n’est pas un dérapage. Dans ce cas-là, le glissement
vers le dialecte n’a rien d’émotif.
(...)
ANDREA CAMILLERI : De mon point de vue, la langue est
tout. C’est le mode de communication que possèdent tous ceux qui appartiennent
à une même nation, c’est le terrain commun sur lequel nous nous plaçons pour
comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Dans d’autres périodes de
notre histoire, quand l’italien n’existait pas encore comme langue officielle,
il n’était ni aisé ni évident de se faire comprendre d’une région d’Italie à
une autre. Je pense à
l’expédition de Garibaldi, à tous ces gens venus de
régions diverses qui n’arrivaient pas à se comprendre, et qui, en deux ou trois
jours de voyage, ont quand même réussi
à
constituer une armée. C’est un miracle qui aujourd’hui encore m’émeut, plus que
l’expédition elle-même. C’est le miracle réalisé grâce à un idéal commun, un objectif
commun, grâce à l’entente qui régnait entre tous ces gens.
C’est ainsi que je
conçois la langue italienne : ce qui nous permet d’atteindre des buts
communs. Voilà pourquoi je tiens à me définir comme un écrivain italien né en
Sicile, et quand je lis écrivain sicilien, cela me met un peu en colère, parce
que je suis un écrivain italien qui utilise l’un des dialectes appartenant à la
nation italienne, un dialecte qui a enrichi notre langue. Si la langue est
l’arbre, les dialectes ont été au cours des siècles la sève de cet arbre. Pour
ma part, j’ai choisi de faire circuler le dialecte dans les veines de mon arbre de la langue italienne, et je pense
que la perte des dialectes est également dommageable pour la vie de
l’arbre.
Pour les italophones, A. Camilleri et T. De Mauro parlent de leur ouvrage dans l'émission de radio
Fahrenheit et dans l'émission de télévision
Pane quotidiano (Rai Tre). Cliquez sur chacun des liens pour accéder aux émissions.



















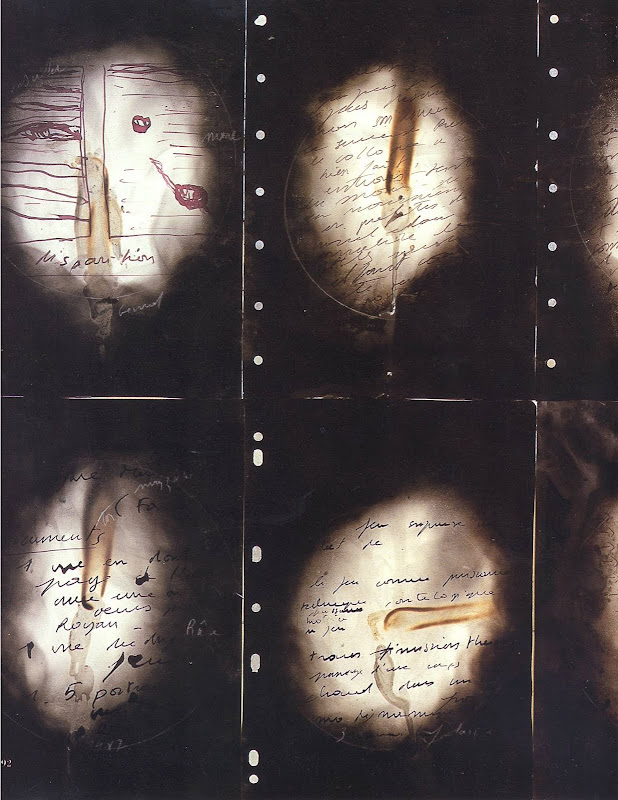


.jpg)















