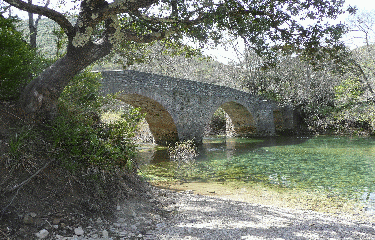"Di nodi d'oro e di gemmati ceppi
Vede c'han forma i mal seguiti amori."
Ariosto Orlando furioso, XXXIV, 68-69
« Je vais
essayer de tout dire. » annonce Dominique Noguez au tout début de son
récit, Une année qui commence bien ; tout dire sur le début d’un amour, sans
passer par le biais de la fiction, ni de la trop rebattue "autofiction", en refusant les artifices du roman tout en restant évidemment dans
la littérature. C’est donc une "confession", au sens de Rousseau
plus que de Saint Augustin, qui est proposée ici au lecteur, lequel va suivre
l’auteur pendant toute une année (1994), avec toutefois des retours en arrière
et des embardées vers le futur, que permettent les presque vingt années de
décalage entre les faits racontés et le moment où le texte est rédigé. Il
s’agit donc de rester au plus près des faits, de reconstituer avec minutie ces
moments inoubliables mais déjà lointains en interrogeant les photographies (l’une d’elles est
même incluse dans l’ouvrage), les carnets et le journal que l’auteur a tenu
minutieusement. Bien sûr, ce que raconte surtout le livre, c’est la naissance
et l’évolution d’une passion (aux multiples sens du terme : croce e
delizia [souffrance et plaisir], comme le dit un air de la Traviata, les références à l’opéra étant d’ailleurs très présentes dans le texte où sont tour à tour évoqués Don Giovanni, La Damnation de Faust, Tristan, Carmen, La Bohème, Tosca, et même La Périchole et son Vice-Roi en goguette incognito).
Noguez se place ici dans les pas de nombreux
prédécesseurs : Proust, bien sûr, davantage du côté d’Albertine que de
celui de Swann et d’Odette, puisqu’il est évident que le jeune homme évoqué dans l'ouvrage est tout à fait le genre du narrateur, et qu’il ne reviendra jamais sur ce
point, même a posteriori (dans les premières pages du livre, il écrit que Cyril et lui ne se voient plus depuis plusieurs années, sans réussir à considérer que leur histoire est finie : « qui peut en jurer ? en moi l'espoir, le fol espoir, ne mourra jamais ») ; on songe aussi au Gide de Si le grain ne meurt,
et plus près de nous à Passion simple, d'Annie Ernaux, et à Incomparable, de Renaud Camus (plusieurs fois cité dans
le livre) et Farid Tali, qui raconte aussi, mais "à chaud", en prise directe,
pourrait-on dire, l’histoire d’un emportement amoureux à sens unique, avec les deux
versions, présentées successivement en deux extraits de journaux intimes :
celui du soupirant, au début de l’ouvrage, et, dans la seconde partie, celui de
l’objet du désir, beaucoup plus détaché et circonspect, avec un effet de miroir cruel mais fascinant pour le
lecteur.
Tout commence donc en novembre 1993, à l’occasion d’un colloque littéraire, où Dominique Noguez rencontre Cyril, un jeune homme blond au
regard bleu qui l’attire irrésistiblement. Ce sera le début d’une longue suite
de plaisirs et de dérobades, de rencontres, de promenades, de baisers (trop)
furtifs et d’étreintes ébauchées et presque aussitôt interrompues, de
rendez-vous prometteurs annulés au dernier moment, parfois même sans que l’on
se soit donné la peine de prévenir, de coups de téléphone complices ou
assassins (il faut dire que, pour ne rien arranger, les contraintes
professionnelles de l’auteur l’obligent à passer une grande partie de cette
année en résidence à Kyoto, et de jongler avec les aléas techniques des communications et les décalages horaires). Croce e
delizia, encore et toujours : connivence et réticence, affection et
indifférence, longs silences et absences répétées suivies de délicieuses mais
provisoires réconciliations, le temps pour le bonheur de "remontrer son
mufle", comme dit drôlement (et amèrement) l'auteur. On pourrait d'ailleurs jouer sur le double sens de l'expression : le bonheur devient hideux puisqu'il est sans cesse provisoire et menacé, et Cyril, la source rayonnante du bonheur, se conduit aussi de façon indélicate et grossière, comme un mufle.
Le jeune homme a vingt-cinq ans, et son soupirant le double de son
âge ; il a la beauté du diable (celle du prince Éric, de Jean Galfione et de Tom Cruise !) et travaille dans le milieu
de la finance (l'équivalent de ce que l’on nommerait aujourd’hui un trader,
métier risqué, mais nous ne sommes pas encore ici dans les années de crise
économique qui marqueront le nouveau siècle) ; il est enthousiaste,
exubérant et attachant, mais aussi égocentrique, un peu mythomane,
ombrageux et versatile. Évidemment, quand la "machine à amour" se met en marche, cela n’ira pas sans tumulte ni frustration
pour Dominique Noguez, celui qui aime le plus (et peut-être même le seul des
deux à aimer…) et qui voit l’objet de cet amour passer son temps à se dérober à
lui (il cite d’ailleurs au passage l’air de Carmen : « Tu crois le
saisir, il t’évite ; tu veux l’éviter, il te tient ! »). Le
régime le plus habituel auquel il est soumis est celui de la douche écossaise,
avec de constantes variations, des périodes où alternent les élans chaleureux
et les rebuffades, voire les humiliations les plus cuisantes : pas vraiment l'enfer, mais un purgatoire plutôt sévère... « Tout
dire », c’est justement rendre compte de tout cela, sans pudeur ni
dissimulation, en allant au cœur de l’aveu, au centre du secret, quitte à
apparaître pitoyable ou ridicule aux yeux du lecteur (la figure de la femme et du pantin n'est jamais très loin).
Ce risque, on peut dire que Noguez l’affronte crânement et résolument, comme s’il se trouvait dans une arène, au risque de la mise à mort (il compare parfois son rapport avec Cyril à une corrida, une faena sentimentale, métaphore d’autant plus frappante que le jeune homme ressemble au torero El Juli…). La sincérité n’exclut toutefois pas la distance ou l’ironie ; Noguez se livre d’ailleurs au fil de son récit (qui est aussi une peinture lucide du milieu littéraire parisien, avec ses rites, ses clans, ses indiscrétions et ses mesquineries) à de nombreuses analyses sur son état, proches des Fragments d'un discours amoureux de Barthes (tout est là : l’absence, l’attente, le ravissement, l’errance, la dépendance, la langueur, l’obscénité…). On se souviendra aussi longtemps de cette extraordinaire théorie du "sexe synthétique", forgée pour lutter contre le découragement du narrateur face aux perpétuelles dérobades de l’être aimé, où il en arrive à se dire qu’en faisant l’assemblage des différents moments d’abandon concédés par Cyril, il arriverait presque à reconstituer un acte sexuel complet !
À la fin de l’ouvrage, l’auteur
s’interroge sur le sens et la nécessité de son entreprise : pourquoi fouiller
dans ces vieilles blessures, pourquoi tomber le masque et s’offrir ainsi en pâture à des lecteurs
qui ne seront sans doute pas tous bienveillants ? La réponse qu’il donne
est double : l’ouvrage qu’il vient d’achever est une sauvegarde
existentielle : « Il me suffit de repenser au travail sisyphéen, tantalien,
presque infini, que constitue toute entreprise amoureuse, pour que les bras
m’en tombent d’avance, et ainsi tout s’arrête avant même de vraiment commencer.
Voilà ce que Cyril m’a apporté sans le savoir : il m’a guéri de
l’amour. » Mais la sauvegarde est aussi esthétique, et Noguez cite à ce propos un
merveilleux passage de l’Orlando furioso (chant XXXIV), celui où Astolphe
arrive sur la Lune et y découvre, au fond d’un vallon encaissé, tout ce qu’on
perd sur la Terre et qui y a été minutieusement conservé : les fumées des
princes, les prières des pécheurs, les vains desseins et les vains désirs, mais
aussi « les larmes et les soupirs des amants ». Tout est là, et tout
est magnifié : « De nœuds dorés et de chaînes de gemmes, il voit
formées les amours malheureuses » (1) ; ainsi, au fil de cette somptueuse
métaphore, le livre devient le réceptacle de la passion, le lieu où elle
continue à vivre et à briller, éternelle comme les étoiles au-dessus du Castel
Sant’Angelo, dans le dernier acte de la Tosca…
Une année qui commence bien, de Dominique Noguez, est paru aux éditions Flammarion.
(1) Traduction : Michel Orcel
Images : Hong Kong, Pedder Street Dan Lai (Site Flickr)
Castel Sant'Angelo Daniele Muscetta (Site Flickr)